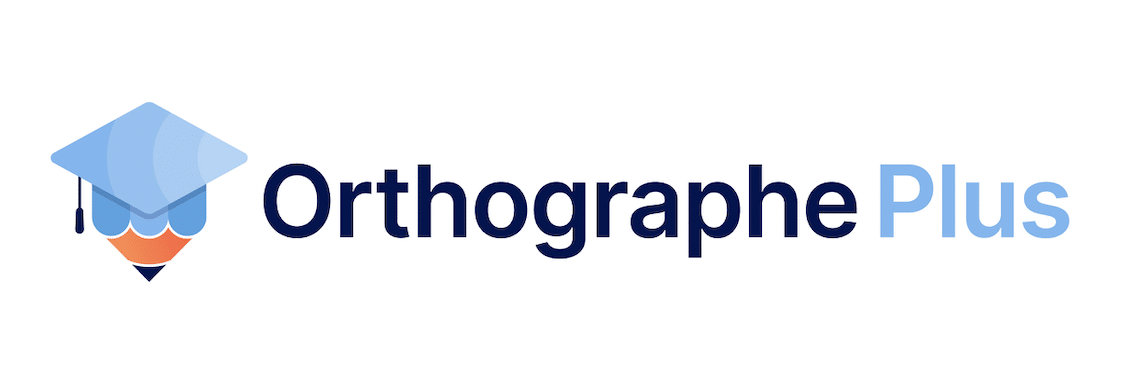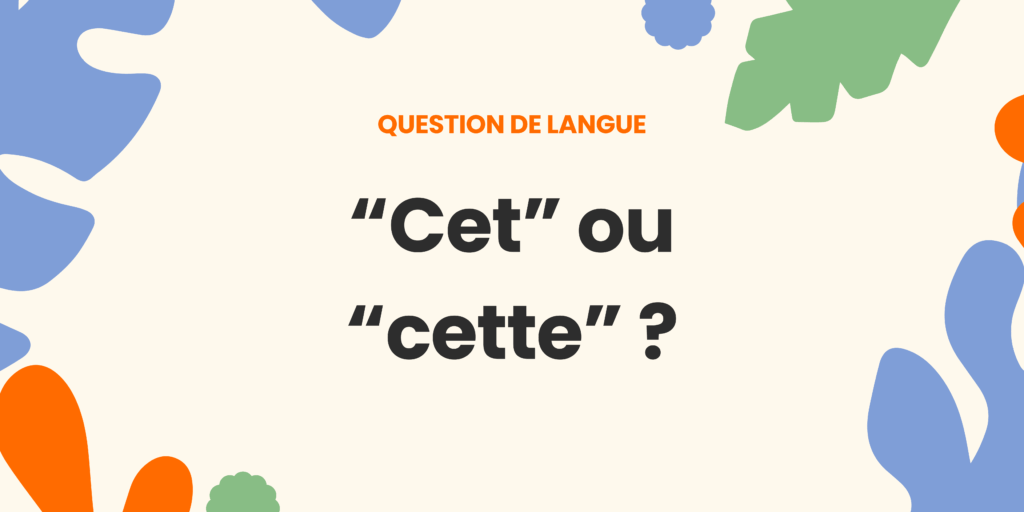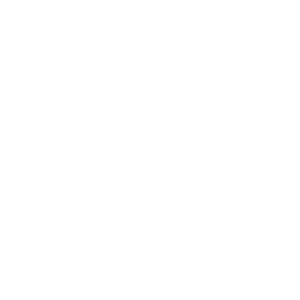FAQ — Orthographe, grammaire, conjugaison et expression
Clique sur une question pour afficher la réponse. Lorsqu’une question s’ouvre, les autres se ferment automatiquement.
Avec « avoir », le participe passé s’accorde avec le complément d’objet direct (COD) si celui-ci est placé avant le verbe. Ex. : « Les lettres que j’ai écrites ». Pas d’accord si le COD est après : « J’ai écrit des lettres ».
« Leur » (sans s) est un pronom ou un déterminant singulier devant un nom singulier : « leur enfant ». « Leurs » (avec s) s’emploie devant un nom pluriel : « leurs enfants ».
« Ces » = déterminant démonstratif (pluriel) ; « ses » = déterminant possessif (pluriel) ; « c’est » = « cela est ». Remplace par « cela est » : si la phrase reste correcte, c’est « c’est ».
Après l’opposition ou la concession (« bien que », « quoique »), on emploie le subjonctif : « Bien qu’il soit tard, nous continuons. »
« Tout » s’accorde devant un adjectif féminin commençant par une consonne : « toute petite ». Il reste invariable devant un adjectif féminin commençant par une voyelle/h muet : « tout heureuse ».
En français, les jours, mois et disciplines prennent la minuscule : « lundi », « octobre », « le français ». Majuscule pour les langues en abréviation de nationalité : « un Français ».
On évite la virgule avant « et » dans une coordination simple. Elle devient utile pour isoler une incise, marquer une opposition ou clarifier une énumération complexe.
Dans l’inversion interrogative, on relie verbe et sujet par un trait d’union : « leur a-t-elle dit ? ». Les pronoms compléments précèdent le verbe sans trait d’union.
Construction déconseillée en français soigné. On préfère « bien que » + subjonctif : « Bien qu’il soit fatigué… ».
L’imparfait décrit le cadre, les habitudes, les actions duratives ; le passé simple marque les actions brèves, achevées et successives qui font avancer le récit.
« Quoique » = « bien que » (subjonctif). « Quoi que » = « quelle que soit la chose que » : « Quoi que tu fasses, reste prudent. »
Avec « plus d’un », le verbe est généralement au singulier : « Plus d’un élève a compris ».
« Demi » reste invariable devant un nom (« une demi-heure ») mais s’accorde après (« une heure et demie »). « Même » s’accorde comme adjectif (« des personnes mêmes ») ; invariable comme adverbe (« lui-même » s’accorde avec le pronom). « Possible » s’accorde au pluriel dans « le plus de choses possibles ».
Après un auxiliaire conjugué, on emploie le participe passé : « j’ai mangé », « je suis parti ». L’infinitif s’emploie après un verbe non conjugué, une préposition ou une locution : « sans manger », « à faire ».
« Parce que » exprime la cause neutre ; « car » justifie souvent après un énoncé ; « puisque » marque une cause connue de l’interlocuteur.
On accorde avec « qui » renvoyant à « je » : « C’est moi qui ai » (et non « ait »), « c’est nous qui avons ».
On utilise « … » (guillemets français) et des espaces insécables avant : ; ! ? et après « ouvrants ». Exemple : « Voici une “citation” ». En typographie française, préférer les guillemets « … ».
À l’affirmatif, les pronoms se postposent et se lient par des tirets : « Donne-le-moi », « Vas-y ». Au négatif, ils reprennent leur place avant le verbe : « Ne me le donne pas ».
« La plupart » commande généralement le pluriel : « La plupart sont venus ». Les compléments de quantité (« une foule de », « un tas de ») accordent selon l’idée dominante, souvent au pluriel : « Une foule de touristes attendaient ».
Scinde en unités logiques, privilégie un verbe fort par proposition, élimine les redondances, remplace les subordonnées lourdes par des participiales ou des relatives courtes.