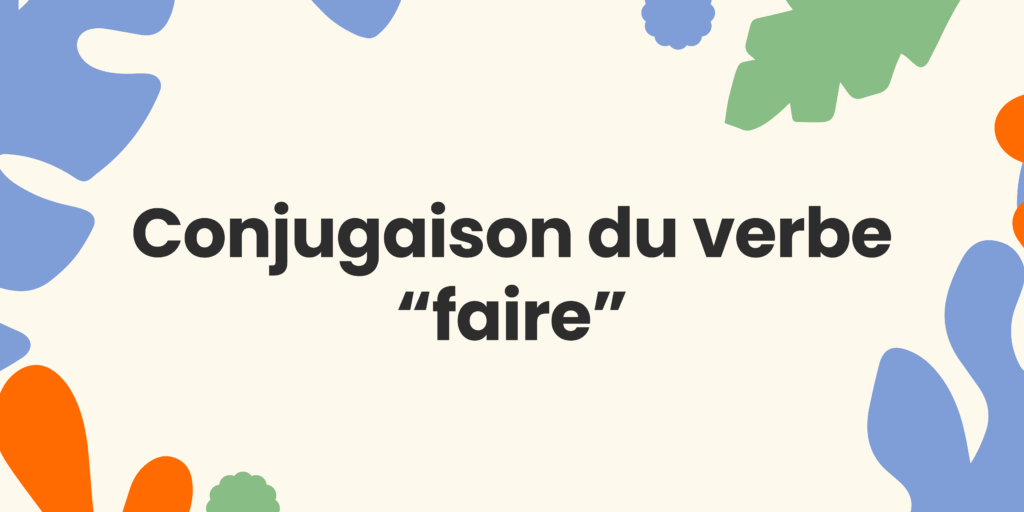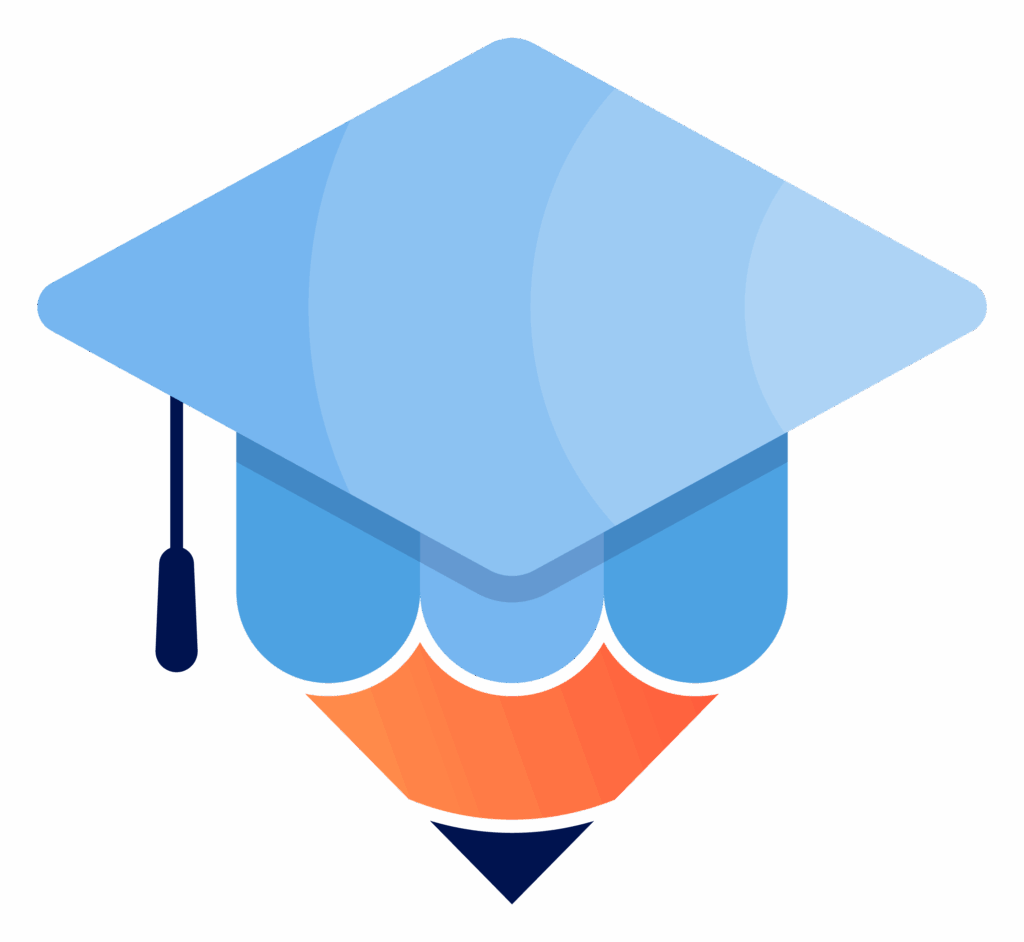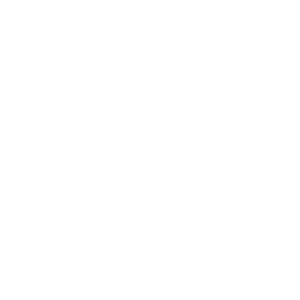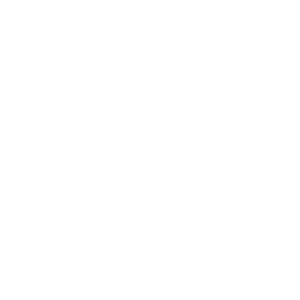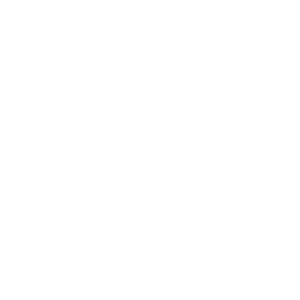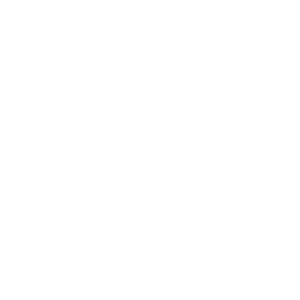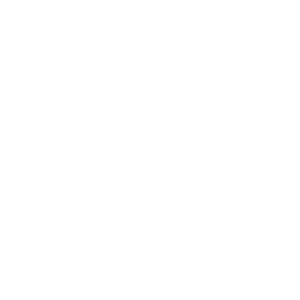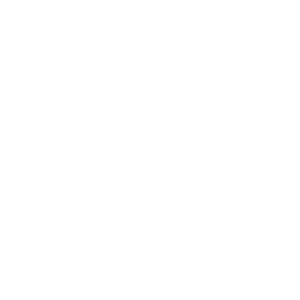Un verbe est un mot essentiel de la langue française : il exprime une action (manger, courir), un état (être, sembler) ou un processus (grandir). Sans verbe conjugué, il n’y a pas de phrase complète, car c’est lui qui porte le temps, la personne et l’aspect. Le verbe est donc l’élément central de la conjugaison et de la syntaxe.
La conjugaison est l’ensemble des règles qui permettent de modifier la forme du verbe pour indiquer le temps (présent, passé, futur), le mode (indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif), la personne grammaticale (je, tu, il/elle…) et le nombre (singulier/pluriel). C’est un système complexe en français, car il existe de nombreux verbes irréguliers.
On distingue trois grands groupes :
1er groupe : tous les verbes en -er (sauf aller), comme chanter, marcher.
2e groupe : les verbes en -ir qui forment leur participe présent en -issant (finir → finissant).
3e groupe : tous les autres, y compris les verbes irréguliers (aller, être, avoir, venir, prendre).
Cette distinction aide à savoir comment conjuguer un verbe.
Pour identifier le groupe d’un verbe, il suffit d’observer sa terminaison à l’infinitif et sa formation au participe présent. Si le verbe se termine en -er, c’est généralement du 1er groupe (sauf aller). Si c’est un verbe en -ir qui donne -issant (finir → finissant), c’est du 2e groupe. Tous les autres verbes, notamment les verbes irréguliers, appartiennent au 3e groupe.
L’infinitif est la forme de base du verbe, non conjuguée. C’est celle que l’on retrouve dans le dictionnaire (chanter, finir, aller). L’infinitif ne porte ni temps ni personne. On distingue l’infinitif présent (parler, finir) et l’infinitif passé (avoir parlé, être parti).
Il existe deux types de modes :
Modes personnels : ils se conjuguent avec des personnes grammaticales (indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif).
Modes impersonnels : ils ne se conjuguent pas avec des personnes mais gardent une valeur verbale (infinitif, participe, gérondif).
Chaque mode a un rôle précis dans l’expression du temps, de la certitude, du doute ou de l’hypothèse.
L’indicatif est le mode de la réalité. Il sert à exprimer des faits considérés comme certains ou objectifs : Je pars demain, elle travaille beaucoup. C’est le mode le plus utilisé, notamment dans la communication quotidienne, car il sert à relater la plupart des actions.
Le subjonctif est le mode du doute, du souhait, de l’incertitude et de l’émotion. On l’emploie après certaines expressions comme il faut que, bien que, pour que, afin que. Exemple : Il faut que tu viennes rapidement. Il exprime des faits envisagés, mais pas encore réalisés.
Le conditionnel permet d’exprimer une hypothèse (si j’avais de l’argent, je voyagerais), une éventualité, ou encore d’atténuer un propos pour plus de politesse (je voudrais un café). C’est un mode très utile dans les situations hypothétiques ou pour projeter une action qui dépend d’une condition.
Le futur simple exprime une action certaine à venir (Demain, j’irai à Paris), alors que le conditionnel présent exprime une action hypothétique ou dépendante d’une condition (J’irais à Paris si j’avais du temps). L’erreur courante est de confondre -rai et -rais, pourtant leur usage est bien différent.
L’impératif est le mode de l’ordre, du conseil ou de la recommandation. Il ne se conjugue qu’à trois personnes : tu, nous, vous. Exemple : Viens !, Mangeons !, Faites attention !. C’est un mode direct qui n’a pas besoin de sujet exprimé.
Le gérondif est une forme verbale qui exprime la simultanéité ou la manière. Il se forme avec en + participe présent (en mangeant, en parlant). Exemple : Il apprend en écoutant. Il permet de montrer deux actions qui se déroulent en même temps.
Les temps simples n’utilisent qu’un seul mot (je chante, il parlait). Les temps composés nécessitent un auxiliaire (être ou avoir) et un participe passé (j’ai parlé, elle est venue). Les temps composés expriment généralement une action antérieure à un temps simple.
Le passé composé se construit avec l’auxiliaire avoir ou être conjugué au présent, suivi du participe passé du verbe : j’ai parlé, tu es parti. Il exprime une action achevée dans le passé, souvent avec un lien vers le présent.
Le plus-que-parfait associe l’imparfait de l’auxiliaire être ou avoir avec le participe passé. Exemple : J’avais terminé mon travail avant qu’il n’arrive. Ce temps exprime une action accomplie avant une autre action passée.
Le futur antérieur exprime une action accomplie dans le futur avant une autre action future. Exemple : Quand tu viendras, j’aurai fini. Il se forme avec le futur simple de être ou avoir + le participe passé.
Le conditionnel passé se construit avec le conditionnel présent de avoir ou être, suivi du participe passé. Exemple : J’aurais aimé venir, elle serait partie plus tôt. Il exprime un regret ou une action hypothétique non réalisée.
L’imparfait exprime des actions longues, habituelles ou descriptives dans le passé (il pleuvait, nous mangions souvent ensemble). Le passé simple marque des actions ponctuelles, brèves, situées dans un récit littéraire (il entra, elle sourit). À l’oral, on emploie surtout le passé composé.
C’est une forme verbale qui sert à construire les temps composés (j’ai mangé) et qui peut aussi avoir une valeur adjectivale (une porte fermée).
Quand il est conjugué avec l’auxiliaire être. Exemple : elle est partie, ils sont arrivés. Le participe passé s’accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet.
Avec l’auxiliaire avoir, si le COD est placé avant le verbe. Exemple : les fleurs que j’ai cueillies (accord avec fleurs placé avant). Si le COD est placé après, il n’y a pas d’accord : j’ai cueilli des fleurs.
Beaucoup confondent infinitif et participe passé (à manger / j’ai mangé). On oublie aussi d’accorder avec être ou avec le COD placé avant. Ce sont parmi les fautes d’orthographe les plus courantes en français.
Un nom est un mot qui désigne une personne (Marie), un objet (table), un lieu (Paris), une idée (liberté). Il peut être commun ou propre et constitue souvent le noyau du groupe nominal.
Un adjectif est un mot qui qualifie un nom en apportant une précision (une belle maison, un travail difficile). Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie.
Un pronom est un mot qui remplace un nom pour éviter les répétitions : il, elle, nous, celui-ci, lequel. Il reprend la fonction du nom dans la phrase.
Un déterminant introduit un nom et en précise le sens (le, la, les, un, ce, ma). Il fait partie intégrante du groupe nominal. Exemple : le chat noir, cette maison.
Le groupe nominal est un ensemble de mots organisé autour d’un nom, appelé le noyau. Exemple : la jolie maison bleue. Le nom central (maison) est accompagné d’un déterminant (la) et éventuellement d’adjectifs (jolie, bleue). Le GN peut jouer plusieurs rôles dans la phrase : sujet (La maison est grande), complément (J’ai visité une jolie maison), ou attribut.
Le groupe verbal est un ensemble de mots construit autour d’un verbe conjugué. Exemple : mange une pomme, ira à Paris demain. Le verbe peut être accompagné de compléments (COD, COI, circonstanciels) qui enrichissent son sens. Le GV est le prédicat de la phrase, c’est-à-dire la partie qui exprime l’action ou l’état.
Le GN est centré sur un nom, tandis que le GV est centré sur un verbe. Exemple : Le chat (GN) + dort sur le canapé (GV). Ensemble, GN et GV forment une phrase complète. Cette distinction est essentielle pour analyser la structure grammaticale.
Le COD complète directement le verbe et répond à la question qui ? quoi ?. Exemple : Je mange une pomme (→ une pomme est COD). Il est directement lié au verbe sans préposition.
Le COI est introduit par une préposition (à, de, avec). Exemple : Je parle à mon ami (→ à mon ami est COI). Il répond à à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ?.
Le CC apporte des précisions sur l’action : lieu, temps, manière, but, cause. Exemple : Il part demain à Paris en train. On distingue CC de lieu, de temps, de cause, de but, de manière, etc.
Le COD est relié directement au verbe, sans préposition (je lis un livre). Le COI, lui, est introduit par une préposition (je parle à un ami). Cette distinction est très importante, car elle influence notamment l’accord du participe passé.
Le sujet est celui qui fait l’action ou subit l’état exprimé par le verbe. Exemple : Paul mange une pomme (→ Paul est le sujet). Le sujet peut être un nom, un pronom ou un groupe nominal.
C’est un mot ou groupe de mots qui donne une information sur le sujet, en lien avec un verbe d’état (être, paraître, sembler). Exemple : Paul est fatigué. Ici, fatigué est attribut du sujet Paul.
L’attribut de l’objet précise une caractéristique du COD. Exemple : Je trouve ce film intéressant. Le mot intéressant est attribut de l’objet film.
C’est un groupe de mots qui précise le sens d’un nom. Exemple : la robe de Marie. Ici, de Marie complète le nom robe.
C’est une proposition qui complète un nom et qui commence par un pronom relatif (qui, que, dont, où). Exemple : La maison qui est au bout de la rue appartient à Paul.
À la voix active, le sujet fait l’action : Paul écrit une lettre. Le schéma est : sujet → verbe → complément.
À la voix passive, le sujet subit l’action : La lettre est écrite par Paul. Le verbe se construit avec être + participe passé. On utilise la voix passive pour mettre en avant le complément plutôt que l’auteur.
La voix pronominale utilise un verbe accompagné du pronom se. Exemple : se laver, se souvenir, s’endormir. Ces verbes peuvent exprimer une action sur soi-même (elle se lave) ou réciproque (ils se parlent).
Parce que les règles changent selon l’auxiliaire utilisé (être ou avoir) et selon la place du COD. Exemple : les fleurs que j’ai cueillies (accord car COD avant) mais j’ai cueilli des fleurs (pas d’accord). C’est l’une des fautes les plus fréquentes dans les dictées.
On peut remplacer par vendre (infinitif) ou vendu (participe passé). Exemple : J’ai fini de vendre/vendu des livres. Cette astuce simple permet de savoir quelle forme est correcte.
Un verbe transitif est un verbe qui nécessite un complément d’objet (COD ou COI). Exemple : manger une pomme, parler à un ami. Le complément est indispensable pour donner un sens complet à l’action.
Un verbe intransitif n’a pas besoin de complément. Exemple : dormir, courir. La phrase est complète avec seulement le sujet et le verbe.
C’est un verbe qui ne se conjugue qu’à la 3e personne du singulier, avec il impersonnel. Exemple : il pleut, il neige. Le il n’a pas de valeur de sujet réel.
Les verbes être et avoir sont auxiliaires. Ils servent à former les temps composés (j’ai mangé, je suis parti). Ils ont un rôle grammatical fondamental dans la conjugaison française.
Un verbe d’état (être, sembler, paraître, devenir, rester, demeurer, avoir l’air) exprime une manière d’être du sujet, et non une action. Exemple : Paul est heureux, elle paraît fatiguée.
C’est un verbe accompagné du pronom se. Exemple : se laver, se promener, se souvenir. Ils se conjuguent avec l’auxiliaire être.
Un verbe défectif est un verbe qui ne se conjugue pas à toutes les formes. Exemple : falloir (il faut), pleuvoir (il pleut), ou choir. Leur emploi est limité mais toujours correct.
La proposition principale est une phrase qui peut exister seule, mais qui peut aussi accueillir une subordonnée. Exemple : Je pars parce qu’il est tard. Ici, je pars est la principale.
Une subordonnée dépend d’une autre proposition pour avoir du sens. Exemple : Je viendrai si tu m’appelles. La subordonnée (si tu m’appelles) ne peut pas exister seule.
C’est une proposition introduite par une conjonction de subordination (que, si, lorsque). Exemple : Je pense qu’il viendra.
C’est une subordonnée construite avec un verbe à l’infinitif. Exemple : Je le vois courir. Le verbe courir n’est pas conjugué mais dépend du verbe principal.
La préposition est un petit mot invariable qui sert à relier des mots entre eux. Exemple : à, de, dans, sur, avec, sans, chez, vers, parmi. Elle introduit souvent un complément : Je vais à Paris, un livre de Marie. Les prépositions sont indispensables pour préciser les rapports de lieu, de temps, de cause ou de possession.
La préposition relie un nom ou un groupe de mots à un autre élément (Je parle à Paul). La conjonction, elle, relie deux propositions entières. Exemple : Je reste parce qu’il pleut. Les deux servent de liens grammaticaux, mais à des niveaux différents.
Les conjonctions de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) relient deux propositions ou deux mots de même nature. Exemple : J’aime le café mais pas le thé. Elles n’expriment pas de dépendance mais un lien logique d’égalité.
Elle relie une proposition subordonnée à une proposition principale. Exemple : Je viendrai si tu m’appelles. On trouve que, si, lorsque, parce que, bien que. Elles introduisent dépendance et nuance logique.
Un adverbe est un mot invariable qui modifie le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre adverbe. Exemple : Il court vite, elle est très belle, tu parles trop fort. Ils précisent le temps, le lieu, la manière, l’intensité.
C’est un groupe de mots qui joue le rôle d’un adverbe. Exemple : tout à coup, à peu près, sans doute, de temps en temps. Même si elle est composée de plusieurs mots, elle reste invariable et fonctionne comme un adverbe simple.
Un verbe irrégulier est un verbe qui ne suit pas les modèles classiques de conjugaison. Exemple : être, avoir, aller, venir, pouvoir, savoir. Ils présentent des radicaux changeants (aller → je vais, nous irons) ou des terminaisons particulières. Ces verbes doivent être appris par cœur, car ils sont très fréquents en français.
Les plus courants sont : être, avoir, aller, faire, dire, pouvoir, vouloir, savoir, voir, venir, prendre, devoir. Comme ce sont des verbes indispensables, les apprendre est une priorité pour maîtriser la conjugaison.
Un verbe supplétif est un verbe qui utilise deux radicaux différents pour se conjuguer. Exemple : aller (je vais, nous irons). Ce phénomène explique certaines irrégularités en conjugaison française.
Il existe des schémas réguliers : -er pour le 1er groupe, -issais pour l’imparfait du 2e groupe, etc. L’astuce est de repérer les modèles et de les appliquer aux verbes réguliers. Pour les verbes irréguliers, l’apprentissage par cœur reste indispensable.
Les verbes du 2e groupe finissent en -ir et forment leur participe présent en -issant (finir → finissant, choisir → choisissant). Attention, tous les verbes en -ir ne sont pas du 2e groupe (ex. partir est du 3e).
Le passé antérieur est un temps littéraire qui exprime une action accomplie avant une autre dans un récit. Exemple : Quand il eut terminé, il partit. Il se forme avec l’auxiliaire avoir ou être au passé simple + participe passé.
C’est un temps rare aujourd’hui, réservé au style littéraire. Exemple : Il fallait qu’il vînt. Il tend à disparaître, remplacé par le subjonctif présent.
C’est une forme archaïque, quasi littéraire, utilisée pour insister. Exemple : j’eusse voulu. Elle se construit avec l’auxiliaire à l’imparfait du subjonctif.
C’est une forme verbale en -ant (chantant, finissant). Il est invariable, sauf quand il est employé comme adjectif verbal. Exemple : une personne charmant (participe) mais une personne charmante (adjectif).
La conjonction relie deux propositions (parce que, lorsque). Le pronom relatif relie une subordonnée à un nom (qui, que, dont, où). Exemple : L’homme qui parle est mon frère.
L’ellipse est la suppression d’un verbe ou d’un mot, sous-entendu par le contexte. Exemple : Pas de problème ! au lieu de Il n’y a pas de problème. C’est fréquent dans le langage oral.
C’est une répétition inutile du sens. Exemple : monter en haut, descendre en bas. Même si on comprend, c’est une faute de style à éviter.
C’est une figure où l’on attribue une action à un sujet qui ne la fait pas vraiment. Exemple : Il a bu un verre joyeux. L’adjectif semble qualifier le verre alors qu’il se rapporte à la personne.
Une phrase française doit toujours comporter un sujet et un verbe. Exemple : Le chat dort. Pour l’enrichir, on ajoute des compléments (COD, COI, CC) et parfois des subordonnées. L’essentiel est d’éviter les phrases trop longues ou mal ponctuées qui nuisent à la clarté.
Phrase simple : un seul verbe conjugué (Paul lit un livre).
Phrase complexe : plusieurs verbes conjugués, reliés par des conjonctions ou des pronoms relatifs (Paul lit un livre pendant que Marie écrit). La phrase complexe enrichit l’expression mais demande une bonne maîtrise des liens grammaticaux.
On peut varier le vocabulaire en utilisant des synonymes, des pronoms (ce dernier, celui-ci) ou des tournures différentes. Exemple : au lieu de répéter l’élève, on peut écrire il, ce jeune, l’apprenant. La richesse du vocabulaire donne plus de fluidité.
La ponctuation forte marque une pause nette (point, point d’interrogation, point d’exclamation, point-virgule). La ponctuation faible rythme la phrase sans la couper totalement (virgule, deux-points, tiret). Bien l’utiliser permet de donner du rythme et de la clarté.
Il est conseillé de limiter une phrase à une idée principale et deux ou trois compléments. Les phrases très longues sont difficiles à lire et peuvent perdre le lecteur. Mieux vaut privilégier la clarté avec des phrases courtes et précises.
Le style soutenu correspond à une écriture soignée, respectant strictement la grammaire, le vocabulaire et la syntaxe. Exemple : Je souhaiterais obtenir des renseignements complémentaires. On l’utilise dans les textes académiques, juridiques ou professionnels.
Soutenu : très soigné, académique.
Courant : standard, utilisé dans la vie quotidienne écrite et orale.
Familier : relâché, oral, parfois incorrect (j’sais pas, c’est cool).
Savoir adapter son style est crucial selon le contexte.
On peut utiliser des verbes introducteurs comme affirmer, déclarer, expliquer, écrire. Exemple : Victor Hugo écrivait : « La liberté commence où l’ignorance finit ». La citation doit être placée entre guillemets français (« ») ou anglais (" ").
Il est utile d’utiliser des connecteurs logiques : d’abord, ensuite, de plus, en revanche, par conséquent, en conclusion. Ces mots guident le lecteur et donnent de la cohérence au texte.
Parce qu’une phrase mal conjuguée brouille le sens et peut décrédibiliser l’auteur. Une conjugaison correcte permet d’exprimer clairement le temps, la durée et la nuance des actions. Elle est la base d’une écriture fluide et professionnelle, que ce soit dans un mail, un rapport ou un texte littéraire.
Le verbe faire est un verbe du troisième groupe, l’un des plus utilisés et des plus irréguliers de la langue française. Il sert à exprimer une action, une fabrication, une obligation (il faut faire) ou encore de nombreuses tournures idiomatiques (faire attention, faire semblant, faire la cuisine). Sa conjugaison est particulière car ses radicaux changent selon les temps (fais-, fer-, fass-).
🔹 Conjugaison de faire à l’indicatif
Présent : je fais, tu fais, il/elle fait, nous faisons, vous faites, ils/elles font.
Imparfait : je faisais, tu faisais, il/elle faisait, nous faisions, vous faisiez, ils/elles faisaient.
Passé simple : je fis, tu fis, il/elle fit, nous fîmes, vous fîtes, ils/elles firent.
Futur simple : je ferai, tu feras, il/elle fera, nous ferons, vous ferez, ils/elles feront.
Passé composé : j’ai fait, tu as fait, il/elle a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils/elles ont fait.
Plus-que-parfait : j’avais fait, tu avais fait, il/elle avait fait, nous avions fait, vous aviez fait, ils/elles avaient fait.
Futur antérieur : j’aurai fait, tu auras fait, il/elle aura fait, nous aurons fait, vous aurez fait, ils/elles auront fait.